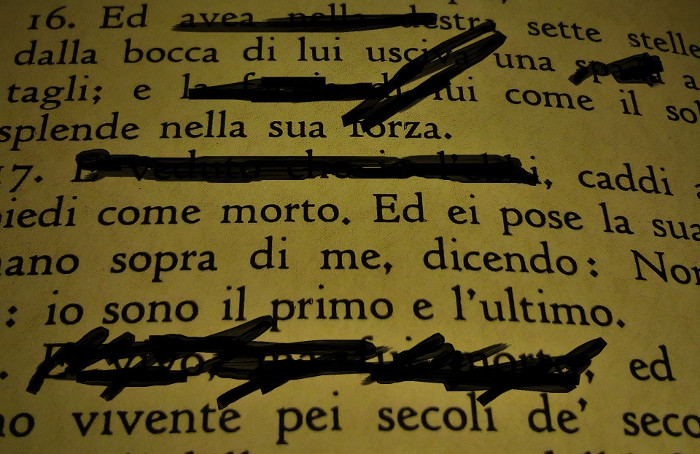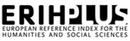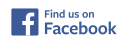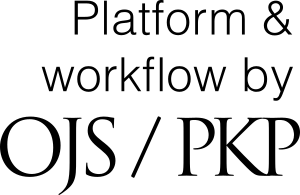Censorship and translingual literature
Abstract
Translingual writers (Ausoni, 2010) are writers who produce literary works, exclusively or not, in a language other than their native one. Their experience of the “linguistic overconsciousness” (Gauvin, 1996), condemnation of every writer – particularly multilingual – to perceive language as an extraneous object, one to be (re)conquered, is exceptionally intense. The literature such writers produce has been defined as “a practice of doubt and discomfort” (Gauvin 1996). Such consciousness of language, along with the plurality of languages and literary spaces (at least two) in which translingual writers act, complicates their relationship with censorship including self-censorship.
From a political point of view, writing in a second language and in a foreign country can free a literary voice which had been censored in its original country; within the “adoptive” language, the relation between what “can” and what “cannot” be told and the confrontation between the mother tongue and other languages are closely related to the writers’ representations of language. In writers’ discourse, the second language often appears as the one which allows them to tell what was forbidden in (by) the mother tongue; sometimes, nevertheless, it appears as the triumph of lies. In other words, it can either be experienced as liberation of expression or as an additional, permanent limitation.
Through a choice of autobiographical contemporary translingual texts by Jorge Semprun, Agota Kristof and Nancy Huston, who all chose to write in French, I will present different possible relations between censorship and the subjective, emotional representations of language we find in their works.
Downloads
References
Ausoni, Alain, «Écriture translingue et autobiographie», L’autobiographie entre autres. Écrire la vie aujourd’hui, Oxford, Peter Lang, 2013: 63-85.
Ausoni, Alain, «‘Ce second cœur dans ma poitrine’: le rapport à la langue française dans les textes autobiographiques d’Andreï Makine et de Nancy Huston», Le Cœur dans tous ses états, Oxford, Peter Lang, 2012: 142-153.
Casanova, Pascale, La république mondiale des lettres, Paris, Seuil, 1999.
Combe, Dominique, Poétiques francophones, Paris, Hachette, 1995.
Durante, Erica, «Agota Kristof: du commencement à la fin de l’écriture», entretien avec l’auteur, Revue Recto/verso, 1. Genèses contemporaines, 2007, en ligne:
http://www.revuerectoverso.com/IMG/pdf/Agota_Kristof_Portrait.pdf
Falceri, Giorgia, « Nancy Huston, Self-Translation and a Transnational poetics», Ticontre. Teoria Testo Traduzione, 2, 2014: 51–66.
Francard, Michel, «Trop proches pour ne pas être différents. Profils de l'insécurité linguistique dans la Communauté française de Belgique», L'insécurité linguistique dans les communautés francophones périphériques, Cahiers de l'Institut Linguistique de Louvain 19 (3-4), 1993: 61-70.
Gasparini, Philippe, Est-il je? Roman autobiographique et autofiction, Paris, Seuil, 2004.
Gauvin, Lise, La fabrique de la langue, Paris, Seuil, 2004.
Grutman, Rainier, Des voix qui résonnent: l’hétérolinguisme au XIX siècle québécois, Montréal, Fides, 1997.
Id., «La traduction ou la survie: Jorge Semprún, Carlos Barral et le prix Formentor», TTR : traduction, terminologie, rédaction, vol. 18, 1, 2005: 127-155.
Huston, Nancy, Désirs et réalités. Textes choisis 1978-1994, Arles, Actes Sud, 1996.
Id., Nord perdu, Arles, Actes Sud, 1999.
Id., Âmes et corps. Textes choisis 1981-2003, Arles, Actes Sud, 2004.
Id., Bad girl. Classes de littérature, Arles, Actes Sud, 2014.
Huston, Nancy et Leila Sebbar, Lettres parisiennes. Histoires d’exil, Paris, Bernard Barrault, 1996.
Kellman, Steven G., The Translingual Imagination, Londres, University of Nebraska Press, 2000.
Kristof, Agota, L’analphabète, Genève, Zoé, 2004.
Id., Romans, nouvelles, théâtre complet, Paris, « Opus » Seuil, 2011.
Porra, Véronique, Langue française, langue d’adoption. Une littérature «invitée» entre création, stratégie et contraintes (1946-2000),Hildesheim, Georg Olm Verlag, 2011.
Semilla Durán, María Angélica, Le masque et le masqué. Jorge Semprún et les abîmes de la mémoire, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2005.
Semprún, Jorge, Le grand voyage, Paris, Gallimard, 1963.
Id., L’écriture ou la vie, Paris, Gallimard, 1994.
Id., Adieu, vive clarté..., Paris, Gallimard, 1998.
Id., Le mort qu’il faut, Paris, Gallimard, 2001.
Id., Une tombe au creux des nuages. Essais sur l’Europe d’hier et d’aujourd’hui, Paris, Flammarion, 2010.
Vexliard, Hélène, «Sous l’emprise totalitaire d’Agota Kristof», La résistance de l’humain, Zaltzman, Nathalie (dir.), Paris, PUF, 1999: 75-106.
Yi, Mi-Kyung, «Épreuves de l’étranger: entretien avec Nancy Huston», Horizons philosophiques, vol. 12, n° 1, 2001 : 1-16.
Copyright Notice
You are free to copy, distribute and transmit the work, and to adapt the work. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).